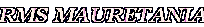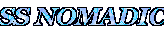Pauvres, mais comment ?
+7
Antoine
Tiphaine
RTR kenny
Joris
Mathusalem
Historiapassionata
CommeDansUneBulle
11 participants
Titanic :: Les Passagers :: 3ème classe
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3 
 Pauvres, mais comment ?
Pauvres, mais comment ?
Je parle des troisièmes classes(même si ca paraît évident).On sait qu'ils sont pauvres,mais ils doivent pas l'être beaucoup vu qu'ils ont réussi à se payer le voyage(pas gratuit).Seulement,voilà,ils devaient pas crever de faims sur les trottoirs mais si ils devaient partir aux états unis c'est pas pour rien .désolé si je pose beaucoups de questions,mais elle me taraude(je suis à fond sur eux  )
)
 )
)
CommeDansUneBulle
-

Messages : 424
Inscrit le : 07/08/2012
Localisation : dans ma bulle
 Re: Pauvres, mais comment ?
Re: Pauvres, mais comment ?
En effet.Je sais pas.Comme dans la petite maison dans la prairie,j'imagine.Mais je suis pas sûr.Mais leur vie aux états unis ressemblera à ça je crois.
Invité- Invité
 Re: Pauvres, mais comment ?
Re: Pauvres, mais comment ?
Pauvres pour en arriver à vendre tous ce qu'ils avaient pour avoir de l'argent et pouvoir payer un ticket sur le Titanic pour toute la famille , le prix du ticket à l'époque revenait a peu près au salaire de ces gens là ( un salaire de quelques mois) mais il pouvait arriver que certains chefs de famille partent seuls pour pouvoir travailler aux usa , mettre leur argent de côté et envoyer le restant à leur femme pour qu'elle le rejoigne avec les enfants ce qui était le cas d'Alma Paulsson qui partait rejoindre son mari avec ses 4 enfants dans l'espoir d'une vie meilleure
 Re: Pauvres, mais comment ?
Re: Pauvres, mais comment ?
Voici un extrait de "La grande armée du drapeau noir" de Georges Blond. Le texte est un peu long, mais il mérite d'être lu jusqu'au bout ; je vous suggère même de l'imprimer. Ça se passe en 1884 et les choses ne sont guère différentes en 1912. L'auteur nous livre une minutieuse description de ce qui attendait les émigrants à leur arrivée aux USA. La pauvreté, c'est ça :
Des familles débarquaient à New York assommées par l'interminable et inconfortable voyage, et les fonctionnaires de l'immigration poussaient hommes, femmes et enfants comme des moutons vers les locaux de contrôle et de désinfection. A peine sortis de là, les immigrants étaient pris en main par des aigrefins parlant plus ou moins leur langue, parfois revêtus de faux uniformes, qui les conduisaient vers de minables hôtels où on leur faisait payer un prix exorbitant. S'ils protestaient, des policemen de mèche avec les voyous les menaçaient, leur montrant du bout de leur matraque les pancartes où tous les prix, disaient-ils, étaient affichés. En dollars, et toutes les inscriptions étaient en anglais, pas en allemand, ni en lituanien, ni en polonais, ni en patois napolitain. La plupart des immigrants ne connaissaient qu'un mot d'américain, le nom de la ville où des parents ou un copain les attendaient, du moins ils l'espéraient. Ceux qui voulaient aller à Chicago répétaient ce nom de Chicago, les aigrefins les conduisaient au Grand Central Depot, leur prenaient leur billet, en continuant à les voler.
Parfois, ils les dépouillaient complètement, abandonnant des familles entières dans la gare, sans un sou, après leur avoir donné des billets faux ou périmés. Les immigrants qui avaient la chance d'être mis dans le train en bonne et due forme regardaient défiler pendant deux journées de voyage le paysage par instants vierge et sauvage, puis couvert de cultures immenses ou assombri de fumées. Le train s'arrêtait au milieu de villes importantes et pleines d'animation, ou à des haltes minuscules, une cabane de bois au milieu du désert. À Chicago, les contrôleurs poussaient dehors ces voyageurs dont certains n'avaient jamais vu un wagon avant d'entreprendre leur grand exode. Les plus ahuris continuaient à répéter Chicago, ne comprenant pas qu'ils étaient arrivés. Le second mot américain que les immigrants apprenaient était job. Ils ne trouvaient pas toujours tout de suite du travail et alors commençaient à s'endetter, empruntant à des taux follement usuraires. Étranglés, ils acceptaient n'importe quel travail à n'importe quel prix. Certain hiver, la direction des usines Durham (conserves de viande) fit paraître dans un journal de Chicago une annonce demandant 200 ouvriers pour telle date. Au jour dit, 3 000 se présentèrent. Ils avaient attendu une partie de la nuit sous la neige, sous un vent glacial. Ils se battaient, les policemen les contenaient à coups de matraque. Une porte fut entrouverte, les vingt premiers entrèrent, la porte fut refermée. Et ne se rouvrit pas. Il ne fallait que vingt ouvriers. Le typographe compositeur de l'annonce s'était trompé d'un zéro. Presque tous les manœuvres employés aux travaux les plus rudes étaient des immigrants, qui tous cherchaient à se loger le plus près possible des usines, dans les banlieues déjà nommées. La banlieue de Chicago, encore aujourd'hui sinistre, est un paradis auprès de ce qu'elle a remplacé. Les rues avaient des noms, et en cela seulement elles ressemblaient à des rues : des espaces de poussière ou de boue ou d'ornières durcies par le gel, voilà ce qu'elles étaient. Parsemées de fondrières remplies d'eau au printemps et à l'automne. Pas de trottoirs. On allait d'une maison à l'autre en passant sur des planches clouées sur pilotis, au-dessus de ruisseaux fétides qui remplaçaient le tout-à-l'égout. Seul assainissement, les grandes pluies, mais elles transformaient les ruisseaux en rivières et les fondrières en étangs. Chaque année, des douzaines d'enfants s'y noyaient. Les promoteurs de certaines banlieues, pour offrir des logements à proximité des usines, avaient sans hésiter construit des quartiers entiers sur des terrains constitués par les détritus de ces usines ou des décharges de quartiers voisins. L'odeur y était terrible par temps chaud, ainsi que les mouches. Celles-ci mouraient l'hiver, mais après avoir pondu et enfoui des larves qui produisaient au printemps d'atroces nuées bleutées. Dans l'extrême banlieue nord, un affluent de la rivière de Chicago était poétiquement nommé « Ruisseau des Bulles ». Tous les égouts des usines à plusieurs kilomètres à la ronde se déversaient dans ce vaste cloaque, large selon les endroits de 30 à 50 mètres. Les graisses et les produits chimiques y produisaient une étrange et constante fermentation. Le ruisseau des Bulles constituait la frontière sud de Parkingtown. Parkingtown n'était pas construit sur des détritus et pourtant l'odeur y était plus pénible que partout ailleurs. À cause de la proximité des Union Stock Yards. Autrement dit des abattoirs. En 1884, les abattoirs de Chicago sentaient mauvais de loin parce que la réfrigération était très imparfaite et parce que les purificateurs de fumée n'existaient pas. Les abattoirs étaient cependant un grand sujet de fierté pour la ville ; des centaines de visiteurs y affluaient chaque jour.
Ils s'émerveillaient de voir les porcs basculer devant une grande roue à crochets, saisis par un pied, entraînés hurlants par une chaîne vers les égorgeurs qui d'un seul geste interrompaient leur cri, et ils admiraient la dextérité des tueurs de bœufs qui abattaient chacun douze animaux en deux minutes. On ne leur montrait qu'une partie des opérations. Les orateurs qui prenaient la parole au cours des meetings d'ouvriers faisaient souvent allusion aux conditions de travail dans les abattoirs :
- Cinquante désosseurs sont morts l'année dernière par empoisonnement du sang après s'être blessés dans leur travail. Il n'y a de lavabos nulle part, de sorte que nos camarades qui emportent à l'usine leur repas de midi doivent le manger avec des mains sanglantes et souillées. Aucun moyen de se laver pour les hommes employés aux sous-produits... Notamment à la fabrication des engrais à base de déchets de viande et d'os pulvérisés.
Ces hommes puaient tellement qu'on ne les laissait pas monter dans les omnibus. Sortis de leur géhenne, ils marchaient interminablement pour regagner les taudis les plus misérables, car la plupart des propriétaires les refusaient aussi. Accepter un travail « aux engrais » signifiait qu'on était arrivé au dernier degré de la misère.
- Camarades, s'écriait un autre orateur, je dois évoquer devant vous un fait particulièrement révoltant. La femme d'un ouvrier de Batavia est allée à l'usine de saindoux pour dire qu'elle n'avait pas vu son mari depuis deux jours.
« Nous non plus, lui a-t-il été répondu. Il a quitté son atelier comme d'habitude il y a deux jours ». Une enquête menée par le syndicat nous a persuadés que cet homme est, en réalité, tombé dans une cuve de cuisson. On n'a rien fait pour le tirer de là et la fabrication a continué. Les témoins de l'accident ne veulent pas témoigner officiellement, de peur de perdre leur place. Ce n'est pas la première fois qu'un ouvrier de l'usine à saindoux est porté disparu. Les cuves s'ouvrent au ras du sol, il n'y a aucune barrière de protection et les contremaîtres ne cessent de pousser l'équipe. Pousser l'équipe voulait dire accélérer le rythme du travail. Dans certaines usines, les ouvriers couraient, dans les pires conditions d'insécurité, par crainte de perdre leur place. Par crainte de perdre leur place, ils se taisaient sur ce qu'ils observaient quotidiennement dans les usines et ateliers de l'orgueilleuse métropole de la viande : contrôleurs refusant de voir les ganglions tuberculeux, chair à saucisse où tout passait, y compris les balayures et les rats crevés, jambons teints chimiquement, pâtés de poulet faits avec des déchets de porc. L'absence d'hygiène et de protection physique, le travail inhumainement rapide, les bas salaires et l'insécurité de l'emploi n'étaient pas le monopole des abattoirs et des conserveries. Un ouvrier d'une chaîne de montage de machines agricoles tombait, pris d'un malaise : interdiction d'arrêter la chaîne pour s'occuper de lui. Un contremaître le poussait un peu en attendant qu'un infirmier arrive. Un ouvrier blessé à l'usine était pansé sommairement et envoyé à l'hôpital. Ensuite chômeur jusqu'à ce qu'il retrouve du travail.
Dans la crainte de perdre leur place les ouvriers acceptaient, s'ils arrivaient avec une minute de retard, de se voir frappés d'une amende équivalant à une heure de travail. Dans la crainte de perdre leur travail encore, les ouvrières des manufactures se livraient aux contremaîtres. En dehors de cette prostitution à l'usine ou à l'atelier, dix mille femmes ou filles étaient chaque année transformées en prostituées à leur arrivée à Chicago : embarquées dès leur descente du train par des souteneurs qui les menaient dans des maisons où on les faisait mettre nues et où on les droguait, alors elles n'osaient plus sortir. Prises au piège, leur destin était tout tracé.
Le salaire d'un ouvrier variait de 700 dollars à 350 dollars par an mais des manœuvres gagnaient beaucoup moins. Dans certaines usines ou conserveries, des hommes gagnaient 250 dollars en travaillant dans des caves glacées, les pieds dans l'eau. Des femmes manipulaient toute la journée des boîtes de conserve ou des pièces de machine pesant de 10 à 20 livres et gagnaient deux ou trois fois moins que les hommes. Des enfants de quatorze ans ou moins (disant qu'ils avaient cet âge) poussaient des boîtes à saindoux devant une machine pendant neuf heures par jour pour un salaire de trois dollars par semaine. Le prix de la chambre dans un bon hôtel de Chicago variait de deux à trois dollars par jour. A l'époque, le dollar valait cinq francs. La ville se développant et s'enrichissant sans cesse, s'enorgueillissait de constructions nouvelles. Le bâtiment contenant l'Hôtel de Ville et le palais de Justice avait coûté 5 millions de dollars, la Poste centrale 5 millions de dollars aussi, la Chambre de Commerce 2 millions. A 16 milles au sud de la ville, Pullman édifiait une usine pour la construction de ses wagons-lits, autour de cette usine une véritable ville qui comptait déjà 12 000 habitants et où s'élevait un hôtel qui devait coûter un million de dollars. Aux syndicalistes revendicateurs qui proclamaient que cette prospérité était fondée sur une exploitation illimitée de la classe ouvrière, les capitalistes répondaient sans la moindre hypocrisie :
- Nous ne sommes ni des politiciens ni des penseurs. Nous sommes des riches. Nous possédons l'Amérique. Nous l'avons conquise par notre travail acharné et en prenant des risques. Et ce que nous avons gagné, nous avons bien l'intention de le garder.
- Mais tandis que vous vous enrichissez, la classe ouvrière s'appauvrit sans cesse !
- C'est la faute des ouvriers qui sont paresseux, ivrognes et sans éducation. D'ailleurs, il y a toujours eu des riches et des pauvres, c'est une loi de la Nature.
Pas la moindre mauvaise conscience. Non seulement à Chicago, mais sur tout le continent américain, la lutte des classes existait à l'état pur.
Des familles débarquaient à New York assommées par l'interminable et inconfortable voyage, et les fonctionnaires de l'immigration poussaient hommes, femmes et enfants comme des moutons vers les locaux de contrôle et de désinfection. A peine sortis de là, les immigrants étaient pris en main par des aigrefins parlant plus ou moins leur langue, parfois revêtus de faux uniformes, qui les conduisaient vers de minables hôtels où on leur faisait payer un prix exorbitant. S'ils protestaient, des policemen de mèche avec les voyous les menaçaient, leur montrant du bout de leur matraque les pancartes où tous les prix, disaient-ils, étaient affichés. En dollars, et toutes les inscriptions étaient en anglais, pas en allemand, ni en lituanien, ni en polonais, ni en patois napolitain. La plupart des immigrants ne connaissaient qu'un mot d'américain, le nom de la ville où des parents ou un copain les attendaient, du moins ils l'espéraient. Ceux qui voulaient aller à Chicago répétaient ce nom de Chicago, les aigrefins les conduisaient au Grand Central Depot, leur prenaient leur billet, en continuant à les voler.
Parfois, ils les dépouillaient complètement, abandonnant des familles entières dans la gare, sans un sou, après leur avoir donné des billets faux ou périmés. Les immigrants qui avaient la chance d'être mis dans le train en bonne et due forme regardaient défiler pendant deux journées de voyage le paysage par instants vierge et sauvage, puis couvert de cultures immenses ou assombri de fumées. Le train s'arrêtait au milieu de villes importantes et pleines d'animation, ou à des haltes minuscules, une cabane de bois au milieu du désert. À Chicago, les contrôleurs poussaient dehors ces voyageurs dont certains n'avaient jamais vu un wagon avant d'entreprendre leur grand exode. Les plus ahuris continuaient à répéter Chicago, ne comprenant pas qu'ils étaient arrivés. Le second mot américain que les immigrants apprenaient était job. Ils ne trouvaient pas toujours tout de suite du travail et alors commençaient à s'endetter, empruntant à des taux follement usuraires. Étranglés, ils acceptaient n'importe quel travail à n'importe quel prix. Certain hiver, la direction des usines Durham (conserves de viande) fit paraître dans un journal de Chicago une annonce demandant 200 ouvriers pour telle date. Au jour dit, 3 000 se présentèrent. Ils avaient attendu une partie de la nuit sous la neige, sous un vent glacial. Ils se battaient, les policemen les contenaient à coups de matraque. Une porte fut entrouverte, les vingt premiers entrèrent, la porte fut refermée. Et ne se rouvrit pas. Il ne fallait que vingt ouvriers. Le typographe compositeur de l'annonce s'était trompé d'un zéro. Presque tous les manœuvres employés aux travaux les plus rudes étaient des immigrants, qui tous cherchaient à se loger le plus près possible des usines, dans les banlieues déjà nommées. La banlieue de Chicago, encore aujourd'hui sinistre, est un paradis auprès de ce qu'elle a remplacé. Les rues avaient des noms, et en cela seulement elles ressemblaient à des rues : des espaces de poussière ou de boue ou d'ornières durcies par le gel, voilà ce qu'elles étaient. Parsemées de fondrières remplies d'eau au printemps et à l'automne. Pas de trottoirs. On allait d'une maison à l'autre en passant sur des planches clouées sur pilotis, au-dessus de ruisseaux fétides qui remplaçaient le tout-à-l'égout. Seul assainissement, les grandes pluies, mais elles transformaient les ruisseaux en rivières et les fondrières en étangs. Chaque année, des douzaines d'enfants s'y noyaient. Les promoteurs de certaines banlieues, pour offrir des logements à proximité des usines, avaient sans hésiter construit des quartiers entiers sur des terrains constitués par les détritus de ces usines ou des décharges de quartiers voisins. L'odeur y était terrible par temps chaud, ainsi que les mouches. Celles-ci mouraient l'hiver, mais après avoir pondu et enfoui des larves qui produisaient au printemps d'atroces nuées bleutées. Dans l'extrême banlieue nord, un affluent de la rivière de Chicago était poétiquement nommé « Ruisseau des Bulles ». Tous les égouts des usines à plusieurs kilomètres à la ronde se déversaient dans ce vaste cloaque, large selon les endroits de 30 à 50 mètres. Les graisses et les produits chimiques y produisaient une étrange et constante fermentation. Le ruisseau des Bulles constituait la frontière sud de Parkingtown. Parkingtown n'était pas construit sur des détritus et pourtant l'odeur y était plus pénible que partout ailleurs. À cause de la proximité des Union Stock Yards. Autrement dit des abattoirs. En 1884, les abattoirs de Chicago sentaient mauvais de loin parce que la réfrigération était très imparfaite et parce que les purificateurs de fumée n'existaient pas. Les abattoirs étaient cependant un grand sujet de fierté pour la ville ; des centaines de visiteurs y affluaient chaque jour.
Ils s'émerveillaient de voir les porcs basculer devant une grande roue à crochets, saisis par un pied, entraînés hurlants par une chaîne vers les égorgeurs qui d'un seul geste interrompaient leur cri, et ils admiraient la dextérité des tueurs de bœufs qui abattaient chacun douze animaux en deux minutes. On ne leur montrait qu'une partie des opérations. Les orateurs qui prenaient la parole au cours des meetings d'ouvriers faisaient souvent allusion aux conditions de travail dans les abattoirs :
- Cinquante désosseurs sont morts l'année dernière par empoisonnement du sang après s'être blessés dans leur travail. Il n'y a de lavabos nulle part, de sorte que nos camarades qui emportent à l'usine leur repas de midi doivent le manger avec des mains sanglantes et souillées. Aucun moyen de se laver pour les hommes employés aux sous-produits... Notamment à la fabrication des engrais à base de déchets de viande et d'os pulvérisés.
Ces hommes puaient tellement qu'on ne les laissait pas monter dans les omnibus. Sortis de leur géhenne, ils marchaient interminablement pour regagner les taudis les plus misérables, car la plupart des propriétaires les refusaient aussi. Accepter un travail « aux engrais » signifiait qu'on était arrivé au dernier degré de la misère.
- Camarades, s'écriait un autre orateur, je dois évoquer devant vous un fait particulièrement révoltant. La femme d'un ouvrier de Batavia est allée à l'usine de saindoux pour dire qu'elle n'avait pas vu son mari depuis deux jours.
« Nous non plus, lui a-t-il été répondu. Il a quitté son atelier comme d'habitude il y a deux jours ». Une enquête menée par le syndicat nous a persuadés que cet homme est, en réalité, tombé dans une cuve de cuisson. On n'a rien fait pour le tirer de là et la fabrication a continué. Les témoins de l'accident ne veulent pas témoigner officiellement, de peur de perdre leur place. Ce n'est pas la première fois qu'un ouvrier de l'usine à saindoux est porté disparu. Les cuves s'ouvrent au ras du sol, il n'y a aucune barrière de protection et les contremaîtres ne cessent de pousser l'équipe. Pousser l'équipe voulait dire accélérer le rythme du travail. Dans certaines usines, les ouvriers couraient, dans les pires conditions d'insécurité, par crainte de perdre leur place. Par crainte de perdre leur place, ils se taisaient sur ce qu'ils observaient quotidiennement dans les usines et ateliers de l'orgueilleuse métropole de la viande : contrôleurs refusant de voir les ganglions tuberculeux, chair à saucisse où tout passait, y compris les balayures et les rats crevés, jambons teints chimiquement, pâtés de poulet faits avec des déchets de porc. L'absence d'hygiène et de protection physique, le travail inhumainement rapide, les bas salaires et l'insécurité de l'emploi n'étaient pas le monopole des abattoirs et des conserveries. Un ouvrier d'une chaîne de montage de machines agricoles tombait, pris d'un malaise : interdiction d'arrêter la chaîne pour s'occuper de lui. Un contremaître le poussait un peu en attendant qu'un infirmier arrive. Un ouvrier blessé à l'usine était pansé sommairement et envoyé à l'hôpital. Ensuite chômeur jusqu'à ce qu'il retrouve du travail.
Dans la crainte de perdre leur place les ouvriers acceptaient, s'ils arrivaient avec une minute de retard, de se voir frappés d'une amende équivalant à une heure de travail. Dans la crainte de perdre leur travail encore, les ouvrières des manufactures se livraient aux contremaîtres. En dehors de cette prostitution à l'usine ou à l'atelier, dix mille femmes ou filles étaient chaque année transformées en prostituées à leur arrivée à Chicago : embarquées dès leur descente du train par des souteneurs qui les menaient dans des maisons où on les faisait mettre nues et où on les droguait, alors elles n'osaient plus sortir. Prises au piège, leur destin était tout tracé.
Le salaire d'un ouvrier variait de 700 dollars à 350 dollars par an mais des manœuvres gagnaient beaucoup moins. Dans certaines usines ou conserveries, des hommes gagnaient 250 dollars en travaillant dans des caves glacées, les pieds dans l'eau. Des femmes manipulaient toute la journée des boîtes de conserve ou des pièces de machine pesant de 10 à 20 livres et gagnaient deux ou trois fois moins que les hommes. Des enfants de quatorze ans ou moins (disant qu'ils avaient cet âge) poussaient des boîtes à saindoux devant une machine pendant neuf heures par jour pour un salaire de trois dollars par semaine. Le prix de la chambre dans un bon hôtel de Chicago variait de deux à trois dollars par jour. A l'époque, le dollar valait cinq francs. La ville se développant et s'enrichissant sans cesse, s'enorgueillissait de constructions nouvelles. Le bâtiment contenant l'Hôtel de Ville et le palais de Justice avait coûté 5 millions de dollars, la Poste centrale 5 millions de dollars aussi, la Chambre de Commerce 2 millions. A 16 milles au sud de la ville, Pullman édifiait une usine pour la construction de ses wagons-lits, autour de cette usine une véritable ville qui comptait déjà 12 000 habitants et où s'élevait un hôtel qui devait coûter un million de dollars. Aux syndicalistes revendicateurs qui proclamaient que cette prospérité était fondée sur une exploitation illimitée de la classe ouvrière, les capitalistes répondaient sans la moindre hypocrisie :
- Nous ne sommes ni des politiciens ni des penseurs. Nous sommes des riches. Nous possédons l'Amérique. Nous l'avons conquise par notre travail acharné et en prenant des risques. Et ce que nous avons gagné, nous avons bien l'intention de le garder.
- Mais tandis que vous vous enrichissez, la classe ouvrière s'appauvrit sans cesse !
- C'est la faute des ouvriers qui sont paresseux, ivrognes et sans éducation. D'ailleurs, il y a toujours eu des riches et des pauvres, c'est une loi de la Nature.
Pas la moindre mauvaise conscience. Non seulement à Chicago, mais sur tout le continent américain, la lutte des classes existait à l'état pur.
_________________


Mathusalem
-

Age : 78
Messages : 5276
Inscrit le : 05/07/2007
Localisation : Sur la passerelle du Californian
 Re: Pauvres, mais comment ?
Re: Pauvres, mais comment ?
Merci de cet extrait pour le moins édifiant  concernant les conditions de travail à la fin du dix-neuvième siècle.
concernant les conditions de travail à la fin du dix-neuvième siècle.
Le style d'écriture, avec forces description me fait énormément penser à la prose de Jack Kérouak.
Le rêve américain n'était pas du tout ce qu'il était dans l'imaginaire des émigrants en quête d'une vie meilleure qui, ne le sera jamais.
Voilà donc ce que mangeaient ensuite les même personnes qui empruntaient les paquebots dans des cabines de première classe: du boeuf et du porc agrémentés d'un soupçon d'emigrant (mais juste un soupçon... à l'occasion).
Denis.
 concernant les conditions de travail à la fin du dix-neuvième siècle.
concernant les conditions de travail à la fin du dix-neuvième siècle. Le style d'écriture, avec forces description me fait énormément penser à la prose de Jack Kérouak.
Le rêve américain n'était pas du tout ce qu'il était dans l'imaginaire des émigrants en quête d'une vie meilleure qui, ne le sera jamais.
Voilà donc ce que mangeaient ensuite les même personnes qui empruntaient les paquebots dans des cabines de première classe: du boeuf et du porc agrémentés d'un soupçon d'emigrant (mais juste un soupçon... à l'occasion).
Denis.
Invité- Invité
 Re: Pauvres, mais comment ?
Re: Pauvres, mais comment ?
ça me rappelle la phrase d'un immigré austro-hongrois : " On nous promettait qu'en Amérique les trottoirs étaient faits en Or , ce qu'ils ne sous ont pas dit c'est que c'était nous qui devions les fabriquer"
 Re: Pauvres, mais comment ?
Re: Pauvres, mais comment ?
Oui je crois que l'extrait de Gérard est révélateur de ce qu'était la pauvreté à cette période, celle qui touchait un grand nombre de passagers de troisième classe, qui, certes avait pu se payer le voyage, mais en même temps c'était pour tenter de vivre une vie meilleure.
Est-ce que tu aurais le nom de cet immigré austro-hongrois s'il te plait ?
Joris
miffy18 a écrit:ça me rappelle la phrase d'un immigré austro-hongrois : " On nous promettait qu'en Amérique les trottoirs étaient faits en Or , ce qu'ils ne sous ont pas dit c'est que c'était nous qui devions les fabriquer"
Est-ce que tu aurais le nom de cet immigré austro-hongrois s'il te plait ?

Joris
_________________
Le Titanic coulait il y a cent douze ans le 15 avril 1912. Une catastrophe maritime que rien
ne laissait prévoir et qui coûta la vie à plus de 1500 personnes.
Une pensée pour toutes les victimes de cet événement tragique qui a eu lieu il y a un siècle
et n'oublions jamais...



Joris
-

Age : 32
Messages : 17688
Inscrit le : 23/02/2007
Localisation : Moselle (57)
 Re: Pauvres, mais comment ?
Re: Pauvres, mais comment ?
Mais c'est horrible ton histoire papy 75! bbvv  je m'attendais pas à ça!Déjà qu'il torture et tue des pauvres petits animaux mais en plus ce que tu dis à propos des gens..Rassures-moi,les survivants de troisième finissaient pas comme ça j'éspère.Comme quoi,c'est pas vraiment la petite maison dans la prairie
je m'attendais pas à ça!Déjà qu'il torture et tue des pauvres petits animaux mais en plus ce que tu dis à propos des gens..Rassures-moi,les survivants de troisième finissaient pas comme ça j'éspère.Comme quoi,c'est pas vraiment la petite maison dans la prairie
 je m'attendais pas à ça!Déjà qu'il torture et tue des pauvres petits animaux mais en plus ce que tu dis à propos des gens..Rassures-moi,les survivants de troisième finissaient pas comme ça j'éspère.Comme quoi,c'est pas vraiment la petite maison dans la prairie
je m'attendais pas à ça!Déjà qu'il torture et tue des pauvres petits animaux mais en plus ce que tu dis à propos des gens..Rassures-moi,les survivants de troisième finissaient pas comme ça j'éspère.Comme quoi,c'est pas vraiment la petite maison dans la prairie
CommeDansUneBulle
-

Messages : 424
Inscrit le : 07/08/2012
Localisation : dans ma bulle
 Re: Pauvres, mais comment ?
Re: Pauvres, mais comment ?
J'aurais préféré que ça te fasse penser à la prose de Gérard Piouffre,Andrews_Thomas a écrit:Le style d'écriture, avec forces description me fait énormément penser à la prose de Jack Kérouak.
 mais hélàs, je suis à des années lumière de Georges Blond
mais hélàs, je suis à des années lumière de Georges Blond 
Malheureusement, la plupart des émigrants finissaient comme ça. La possibilité de faire fortune aux Amériques existait, mais elle était aussi improbable que celle de gagner le gros lot au loto. Cette époque était impitoyable.CommeDansUneBulle a écrit:Mais c'est horrible ton histoire papy 75! bbvvje m'attendais pas à ça!Déjà qu'il torture et tue des pauvres petits animaux mais en plus ce que tu dis à propos des gens..Rassures-moi,les survivants de troisième finissaient pas comme ça j'éspère.Comme quoi,c'est pas vraiment la petite maison dans la prairie
_________________


Mathusalem
-

Age : 78
Messages : 5276
Inscrit le : 05/07/2007
Localisation : Sur la passerelle du Californian
 Re: Pauvres, mais comment ?
Re: Pauvres, mais comment ?
Ben dis donc, vraiment très très dur comme vie.....vraiment horrible, en tout cas merci papy75 de nous avoir fait partager cet extrait.
Au final si certains passagers de troisième classe étaient parties pour vivre une vie identique, le destin du Titanic les à peut être "sauvés"......
Au final si certains passagers de troisième classe étaient parties pour vivre une vie identique, le destin du Titanic les à peut être "sauvés"......

 Re: Pauvres, mais comment ?
Re: Pauvres, mais comment ?
Ils finissent soit au fond de l'eau,soit comme ça...et moi qui pensait qu'ils allaient vivre comme les ingalls à walnut grove..quelle idiote je fais!
Invité- Invité
 Re: Pauvres, mais comment ?
Re: Pauvres, mais comment ?
Papy 75 a écrit:J'aurais préféré que ça te fasse penser à la prose de Gérard Piouffre,Andrews_Thomas a écrit:Le style d'écriture, avec forces description me fait énormément penser à la prose de Jack Kérouak.mais hélàs, je suis à des années lumière de Georges Blond

Mais j'adore tout autant ta prose Gérard qui est beaucoup plus accessible et digeste que Kérouac dont il faut plusieures fois lire les phrases tant elles sont longues. Donc entre Gérard Piouffre et Jack (pas Dawson
 ), je choisis Gérard.
), je choisis Gérard.Rosedawson 2 a écrit:Ils finissent soit au fond de l'eau,soit comme ça...et moi qui pensait qu'ils allaient vivre comme les ingalls à walnut grove..quelle idiote je fais!
A leur arrivée à New-York les survivants de troisième classe ont néanmoins eu la chance d'échapper aux "formalités" administratives de Ellis Island. C'était une sorte de centre où tout étranger (immigrant) postulant à une vie aux Etat-Unis devait passer. Ceux qui présentaient des signes de maladie étaient d'office renvoyés d'où ils venaient sans jamais pouvoir débarquer de l'île ou étaient gardé en quarantaine sur cette même île. Les autres, ceux qui étaient sains, devaient répondre à une liste de question avant de pouvoir débarquer à New-York.
Suite à l'extrait de Gérard on peut se demander si ce n'était pas mieux qu'ils restent chez eux.
Denis.
Invité- Invité
 Re: Pauvres, mais comment ?
Re: Pauvres, mais comment ?
Il est bizzare ton nom de famille,gérard
Pour en revenir au sujet,la vie a été plus belle sous l'océan
Pour en revenir au sujet,la vie a été plus belle sous l'océan

Invité- Invité
 Re: Pauvres, mais comment ?
Re: Pauvres, mais comment ?
Un grand merci pour cet extrait, Gérard (ça a dû te prendre du temps à le taper), j'ai beaucoup aimé. Sans surprise, j'ai déjà lu des choses de ce genre et c'est vrai que la vie n'était pas facile. C'était de la survie quotidienne. Tout cela me fait aussi penser au quartier des Five Points que l'on voit dans le film Gangs of New York.
Je ne connaissais pas cette phrase. Elle est magnifique je trouve, ça résume bien les choses.
miffy18 a écrit:ça me rappelle la phrase d'un immigré austro-hongrois : " On nous promettait qu'en Amérique les trottoirs étaient faits en Or , ce qu'ils ne sous ont pas dit c'est que c'était nous qui devions les fabriquer"
Je ne connaissais pas cette phrase. Elle est magnifique je trouve, ça résume bien les choses.

Tiphaine
-

Age : 35
Messages : 4914
Inscrit le : 09/07/2010
Localisation : Vallée de la Creuse
 Re: Pauvres, mais comment ?
Re: Pauvres, mais comment ?
D'après un ami linguiste, ça viendrait de "piouvre" qui veut dire "pieuvre" en provençal. C'est un animal qui me va bien. La pieuvre se propulse par réaction, comme les avions à bord desquels j'ai volé, elle jette de l'encre comme moi quand j'écris mes bouquins et elle a huit bras pour tout faire en même temps !Florentine Mayard a écrit:Il est bizzare ton nom de famille,gérard

_________________


Mathusalem
-

Age : 78
Messages : 5276
Inscrit le : 05/07/2007
Localisation : Sur la passerelle du Californian
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3 
 Sujets similaires
Sujets similaires» Vivre, mais de quoi ?
» Mais où est donc le Lyubov Orlova?
» Mais d'où venait tout cet argent ?
» Le film,mais sans l'histoire d'amour:
» A priori, rien a voir avec le Titanic, mais.......
» Mais où est donc le Lyubov Orlova?
» Mais d'où venait tout cet argent ?
» Le film,mais sans l'histoire d'amour:
» A priori, rien a voir avec le Titanic, mais.......
Titanic :: Les Passagers :: 3ème classe
Page 1 sur 3
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
 CommeDansUneBulle Sam 25 Aoû 2012 - 12:10
CommeDansUneBulle Sam 25 Aoû 2012 - 12:10